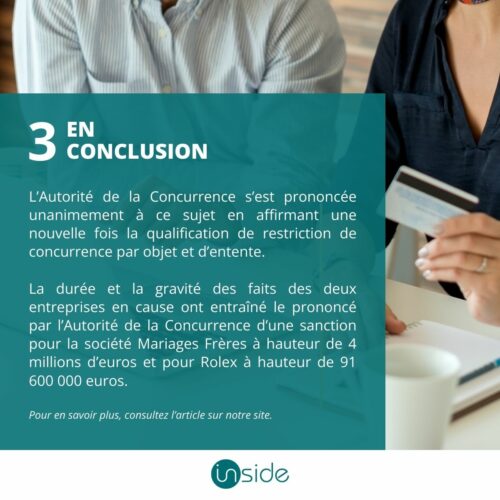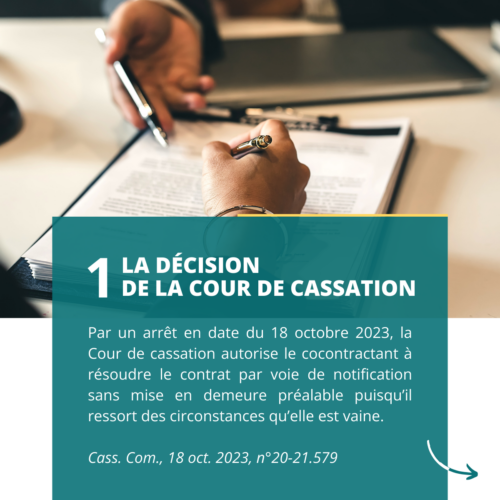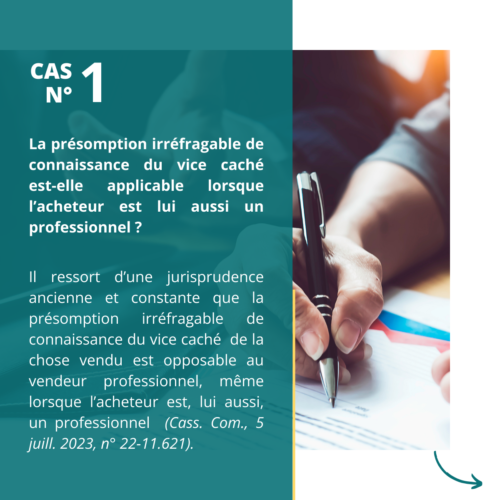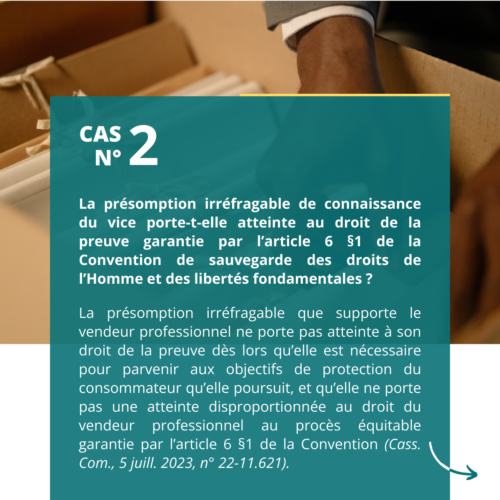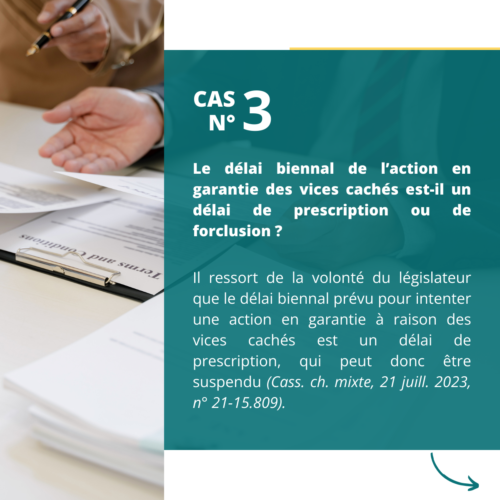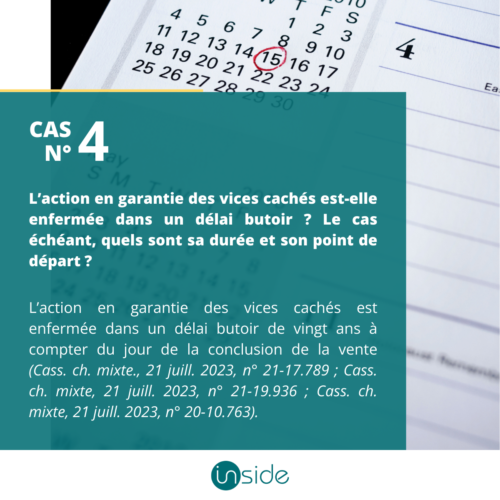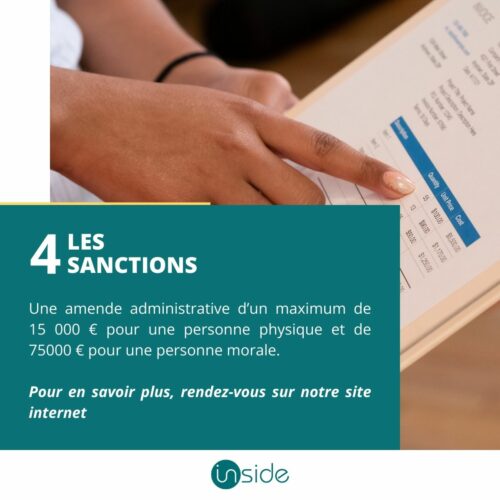Le Code civil met à la charge du vendeur plusieurs obligations parmi lesquelles on retrouve la garantie contre les vices cachés. Elle est définie à l’article 1641 du même code comme la garantie à laquelle est tenu le vendeur lorsque la chose vendue contient un défaut caché qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Si la garantie des vices cachés existe depuis 1804 dans le Code civil, il reste encore des questions sans réponse concernant le régime juridique qu’on lui applique. Fort heureusement, la Cour de cassation est revenue sur certaines d’entre elles.
Par un arrêt du 5 juillet 2023 de la chambre commerciale[1], la Cour de cassation revient sur l’applicabilité de la présomption irréfragable de connaissance du vice caché et répond à la question de savoir si une telle présomption contrevient au droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
A l’occasion de quatre arrêts rendus le 21 juillet 2023 par la chambre mixte[2], la Cour de cassation revient sur la qualification du délai biennal consacré à l’article 1648 du Code civil et sur la très controversée existence d’un délai butoir dans lequel sera enfermé ledit délai biennal, ainsi que, s’il existe, sa durée et son point de départ, dans un souci d’unification de la jurisprudence, de protection des droits des consommateurs et face aux impératifs de la vie économique[3].
Ces décisions interviennent à un moment tout à fait opportun alors que la Chancellerie a publié il y a presque un an son projet de réforme du droit des contrats spéciaux et qu’une consultation publique a eu lieu jusqu’en novembre 2023[4]. Par cette série d’arrêts, on peut légitimement se demander si la Cour de cassation ne tenterait pas d’influencer le législateur, à la veille de l’adoption de la réforme.
I. La présomption irréfragable de connaissance du vice caché est-elle applicable lorsque l’acheteur est lui aussi un professionnel ?
En l’espèce, une société constate que le moteur du tracteur qu’elle a acquis et mis en circulation est affecté d’un vice caché. Elle assigne la société venderesse en résolution judiciaire du contrat de vente, ce qui est reconnu par les tribunaux de première instance puis la cour d’appel de Caen.
La société venderesse et son assureur se pourvoient en cassation et arguent que l’application qui est faite par les juridictions inférieures de la présomption irréfragable de connaissance du vice caché par le vendeur professionnel ne peut pas jouer dès lors que l’acquéreuse est elle-même un professionnel[5].
La Cour de cassation juge que la présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue joue même lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel, conformément à une jurisprudence ancienne et constante (Cass. 1er Civ., 21 nov. 1972, bull. n°257 ; Civ. Com., 19 mai 2021, n°19-18.230).
II. La présomption irréfragable de connaissance du vice porte-t-elle atteinte au droit de la preuve garanti par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ?
Dans ce même arrêt, pour se soustraire à la présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue, le vendeur professionnel invoquait l’argument selon lequel cette présomption « méconnaît le droit au procès équitable garanti par l’article 6, §1, de la Convention, la règle de droit nationale portant une atteinte disproportionnée au droit à la preuve d’une partie »[6], d’autant plus alors que l’acheteur en l’espèce agissait dans l’exercice de sa propre activité professionnelle.
Toutefois, la Cour juge que ladite présomption a pour objet de « contraindre [le] vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente »[7] et répond donc « à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences »[8]. La présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue par le vendeur professionnel est donc nécessaire pour parvenir audit objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garantie par l’article 6 §1 de la Convention.
III. Le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés est-il un délai de prescription ou de forclusion ?
Dans une volonté d’unification de la jurisprudence, la Cour de cassation revient sur la qualification du délai biennal dont on dispose pour engager une action en garantie des vices cachés.
Il existait une divergence de jurisprudence au sein même de la 3e chambre civile de la Cour de cassation qui avait pu tantôt qualifier le délai de l’action en garantie des vices cachés de délai de forclusion[9], tantôt traiter ce délai comme un délai de prescription[10], laissant la doctrine perplexe[11].
La Cour de cassation réunie en chambre mixte met fin au débat en jugeant que le délai biennal prévu pour intenter une action en garantie en raison des vices cachés est un délai de prescription, qui peut donc être suspendu[12].
Pour ce faire, elle s’intéresse alors à la volonté du législateur[13]. Elle retient, d’une part, que les rapports accompagnant l’ordonnance n°2005-136 et le projet de loi de ratification font mention de l’existence d’un délai de prescription, et, d’autre part, que l’objectif poursuivi par le législateur est de permettre à tout acheteur, consommateur ou non, de bénéficier d’une réparation en nature, d’une diminution du prix ou de sa restitution lorsque la chose est affectée d’un vice caché, et que pour ce faire, l’acheteur doit être en mesure d’agir contre le vendeur dans un délai susceptible d’interruption et de suspension[14].
À la veille de la réforme du droit des contrats spéciaux, l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux rendu public par le ministère de la Justice ne qualifie pas explicitement le délai biennal de délai de prescription ou de forclusion[15]. Il faut espérer que, d’ici l’adoption de la réforme, le législateur consacre l’arrêt d’espèce rendu par la chambre mixte afin de mettre fin une bonne fois pour toutes à la controverse jurisprudentielle.
IV. L’action en garantie des vices cachés est-elle enfermée dans un délai butoir ? Le cas échéant, quels sont sa durée et son point de départ ?
La Cour de cassation, toujours réunie en chambre mixte, est aussi revenue sur l’existence d’un délai butoir au sein duquel est enfermée l’action en garantie des vices cachés, et, s’il existe, de la durée de ce délai et de son point de départ[16].
La Cour de cassation consacre l’existence d’un tel délai butoir dans lequel est enfermée l’action en garantie des vices cachés et revient sur la durée d’un tel délai et son point de départ.
Il existe un débat doctrinal et jurisprudentiel concernant le faire de savoir s’il faut encadrer l’action en garantie des vices cachés dans le délai butoir de vingt ans prévu à l’article 2232 du Code civil ou le délai butoir de cinq ans prévu à l’article L. 110-4 du Code de commerce.
La Cour de cassation considère que le délai de vingt ans de l’article 2232 du Code civil constitue le délai butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées[17].
Par ailleurs, ce délai butoir court à compter de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie[18].
L’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux hésite toujours, quant à lui, sur la durée du délai butoir et prévoit deux options : une première de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, et une seconde de dix après la délivrance de la chose vendue[19]. Les arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation arrivent donc à point nommé, sans doute pour tenter d’influer sur la décision finale du législateur.
———-
[1] Cass. Com., 5 juill. 2023, n° 22-11.621.
[2] Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809 ; Cass. ch. mixte., 21 juill. 2023, n° 21-17.789 ; Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-19.936 ; Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10.763.
[3] Communiqué de la Cour de cassation, « Vices cachés – dans quel délai l’action en garantie peut-elle être engagée ? », 21 septembre 2023.
[4] BRASSSAC L., « Réforme du droit des contrats spéciaux : ‘Nous avons conservé certains numéros emblématiques’ », Interview de Philippe Stoffel-Munck, président de la Commission ayant travaillée sur le projet de réforme du droit des contrats spéciaux, Dalloz Actualité, 30 septembre 2022.
[5] SERINET Y.-M., « Ventes entre professionnels et présomption de connaissance du vice affectant la chose objet du contrat », La Semaine Juridique Édition Générale n°28, LexisNexis, 17 juillet 20223, act. 866.
[6] Cass. Com., 5 juill. 2023, n° 22-11.621.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n°15-24.289 ; Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n°20-22.670.
[10] Cass. 3e civ., 15 janv. 2017, n°15-12.605 ; Cass. 3e civ., 11 avr. 2018, n°17-14.091.
[11] MAZEAUD-LEVENEUR S., « Le délai biennal de la garantie des vices cachés : forclusion ou prescription ? », La Semaine Juridique Edition Générale, Dalloz, n°3, 24 janvier 2022, act. 89.
[12] Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809, pt. 21.
[13] DE ANDRADE N., « Du double délai pour agir en garantie des vices cachés : épilogue », Dalloz Actualité, 13 septembre 2023.
[14] Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809, pt. 17.
[15] ROBIN-SABARD O., « Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : vente – vices cachés », Le droit en débats, Dalloz Actualité, 11 juillet 2022.
[16] Communiqué de la Cour de cassation, « Vices cachés – dans quel délai l’action en garantie peut-elle être engagée ? », 21 septembre 2023.
[17] Cass. ch. mixte., 21 juill. 2023, n° 21-17.789, pt. 11 ; Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-19.936, pt. 16 ; Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10.763, pt. 20.
[18] Cass. ch. mixte., 21 juill. 2023, n° 21-17.789, pt. 15 ; Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-19.936, pt. 19 ; Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10.763, pt. 27.
[19] ROBIN-SABARD O., « Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : vente – vices cachés », Le droit en débats, Dalloz Actualité, 11 juillet 2022.