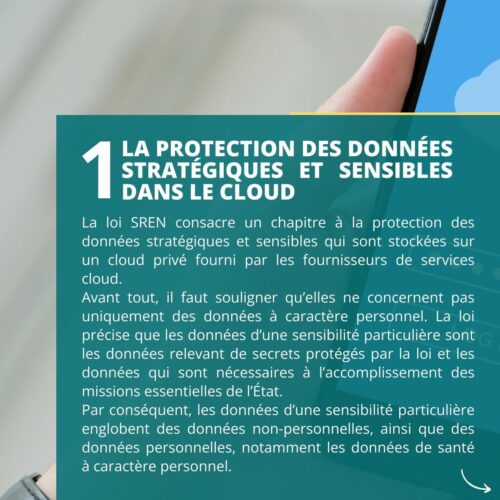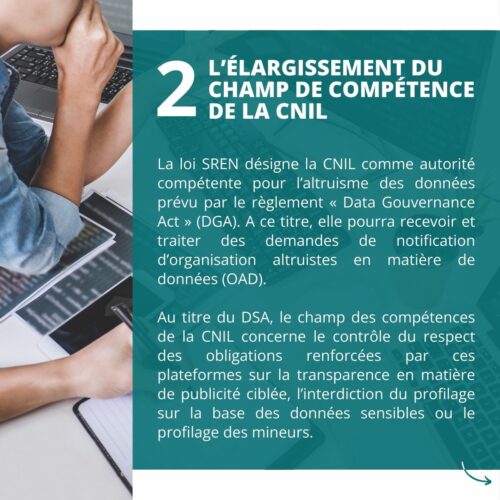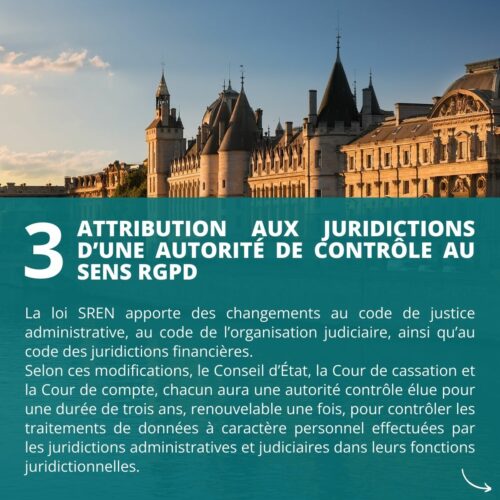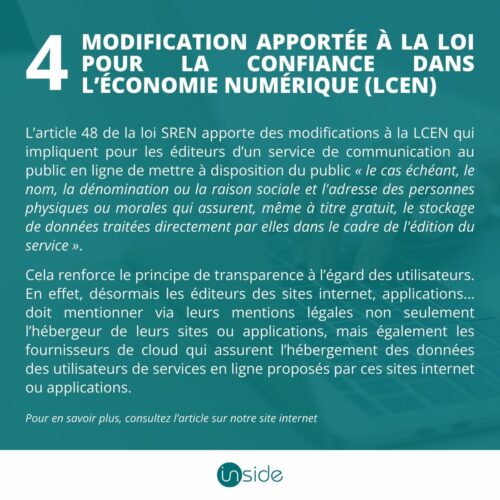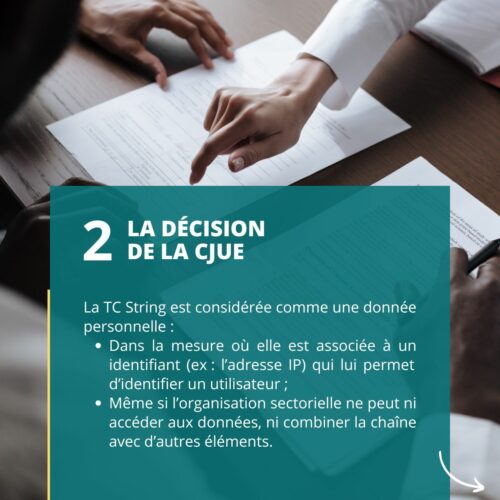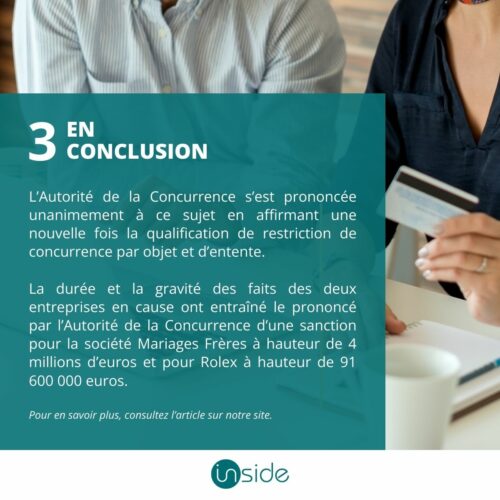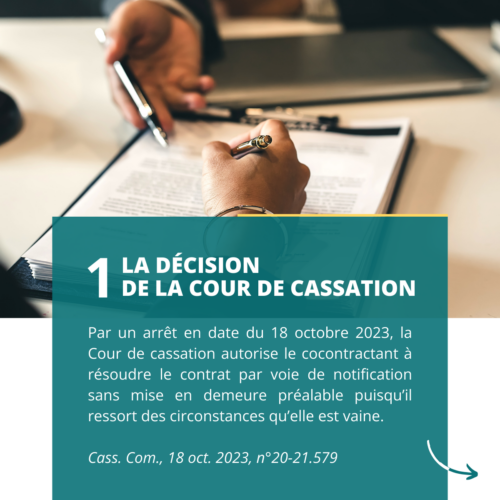Les acteurs de l’écosystème de la prospection commerciale, et de la publicité ciblée, cherchent souvent à s’affranchir des règles juridiques au détriment de leurs concurrents et de la protection des droits et libertés des individus.
En outre, le domaine de la prospection fait parfois intervenir une multitude d’acteurs, formant une « chaîne » par laquelle transitent les données des prospects. Cette multiplicité d’acteurs augmente le risque de non-respect des règles juridiques. Ainsi, il arrive parfois que « chaque maillon de la chaîne achète des données du maillon précédent en fermant les yeux sur la légalité de la collecte originelle ». Par conséquent, « une ignorance volontaire ou involontaire de la loi à un seul endroit dans la chaîne [suffis] pour que les données personnelles de millions de personnes soient marchandées illégalement avec des centaines d’entreprises »[1].
Afin de responsabiliser l’ensemble des acteurs, la CNIL[2] adopte une interprétation stricte des dispositions légales applicables, dont le RGPD[3] ainsi que les autres dispositions spécifiques[4] aux opérations de prospection commerciale ou de retargeting publicitaire. Ainsi, la CNIL a récemment sanctionné deux sociétés dans le cadre de leurs pratiques en matière de prospection respectivement[5] et de retargeting publicitaire en ligne[6]. Dans les deux cas de figure était notamment en cause le respect des obligations en matière de recueil du consentement des personnes concernées, et de preuve de la validité de ce dernier.
Ainsi, afin de sécuriser les opérations de prospection commerciale, il est primordial de respecter les (I.) règles juridiques en matière de prospection commerciale, dont la CNIL a une interprétation stricte (II.) notamment en matière d’information des prospects lors du recueil de leur consentement à des fins de prospection commerciale. Lorsqu’une chaîne d’intermédiaires est impliquée dans les opérations de prospection, la sécurisation passe par (III.) un encadrement et une collaboration étroite entre les prospecteurs et les primo-collectant des données.
I. Les règles juridiques applicables aux opérations de prospection commerciale
En réalité, toutes les opérations de prospections de prospection commerciales ne nécessitent pas nécessairement de recueillir préalablement le consentement des prospects. Dans certains cas de figure, le Responsable de traitement peut opérer un choix entre le consentement (dit « opt-in »), et l’intérêt légitime[7] (ou « opt-out »).
Ainsi, le recueil du consentement est imposé dans les cas de figure suivants :
- Pour le dépôt de cookies ayant des finalités publicitaires, ou de suivi à des fins publicitaires[8] ;
- Ainsi que pour la prospection directe par voie électronique (par SMS, MMS, e-mail)[9].
Lorsque les opérations de prospection commerciale, ou de retargeting publicitaire, sont fondées sur le consentement de la personne concernée, le Responsable de traitement doit s’assurer de la validité de ce dernier[10]. Il doit notamment informer la personne concernée[11], mettre en place un mécanisme pour que ce dernier se manifeste par un acte positif de la personne concernée [11], et lui fournir un moyen lui permettant de retirer ce consentement à tout moment[12].
La CNIL reconnaît la possibilité de choisir entre le consentement, et l’intérêt légitime, pour les cas de figure suivants :
- La prospection commerciale par mail d’une personne déjà cliente pour des produits ou services analogues à ceux déjà achetés[13] ;
- La prospection commerciale à destination de professionnels lorsqu’elle est en lien avec leur profession[14] ;
- La prospection commerciale par voie postale, ou téléphonique hors automates d’appel[15].
Dès lors, il sera nécessaire de prévoir cumulativement : l’information de la personne concernée[16], et un mécanisme permettant de s’opposer à la prospection commerciale lors de la collecte des données ainsi qu’à tout moment lors des activités de prospection commerciale[17].
En cas de non-respect de ces dispositions, le Responsable de traitement s’expose notamment à une sanction administrative de la CNIL d’un montant maximal de 20 millions d’euros, ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu[18]. Ce dernier s’expose également à une sanction pénale pour tout détournement de finalités, pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende[19].
II. L’importance de l’information des prospects lors du recueil de leur consentement à des fins de prospection commerciale
Dans de nombreux cas de figure, le prospecteur ne collecte pas directement les coordonnées du prospect. Un intermédiaire, dit « primo-collectant » transmet alors les données collectées auprès des prospects au prospecteur. Lorsque les opérations de prospection commerciale reposent sur le consentement, il sera nécessaire de s’assurer que le primo-collectant a correctement collecté le consentement de ces des prospects.
Ainsi, le prospect consent-t ’il à la transmission de ses données à des prospecteurs clairement identifiés, ou peut-il seulement consentir à la transmission de ses données à des catégories de prospecteurs ?
La CNIL avait déjà pris position dans une précédente sanction en date du 24 novembre 2022 en considérant que pour que le consentement soit valide « les personnes doivent notamment être clairement informées de l’identité du prospecteur pour le compte duquel le consentement est collecté et des finalités pour lesquelles les données seront utilisées »[20]. Cette exigence équivaut donc à fournir clairement les objectifs de prospections commerciales liées à la transmission des données, ainsi que la liste exhaustive des prospecteurs.
Cette position est confirmée dans la récente sanction à l’encontre de la société CANAL +[5] prononcé par la CNIL. Il faudra alors fournir aux prospects, lors du recueil du consentement, « une liste exhaustive et mise à jour, […] par exemple directement sur le support de collecte ou, si celle-ci est trop longue, via un lien hypertexte renvoyant vers ladite liste et les politiques de confidentialité des prestataires et fournisseurs ». Juridiquement, la CNL fait une lecture « combinée des articles L. 34-5 du CPCE et 7, paragraphe 1, du RGPD » tel qu’éclairé par « l’article 4, paragraphe 11, du RGPD », pour établir que le consentement ne peut être informé que lorsque la personne a expressément consenti au traitement de ses données par ce même Responsable de traitement prospecteur.
En d’autres termes, pour la CNIL, le prospect ne consent qu’à la transmission de ses données auprès des seuls prospecteurs clairement identifiés comme destinataires des données lors de la collecte du consentement. Ainsi, une double information est donc à fournir aux prospects dans ce cas de figure. Du point de vue du primo collectant, il s’agit d’une collecte directe[21] ce dernier devra donc fournir les mentions d’information relative à l’article 13 RGPD. Le prospecteur se voyant transmettre les données, dois fournir dans le cadre de la collecte indirecte des données l’ensemble des mentions d’informations ainsi que la source des données[22].
En outre, si les seules catégories de destinataires figurent dans les mentions d’informations lors du recueil du consentement, une solution de contournement devra être mise en place. Afin de permettre au prospecteur de prospecter par voie électronique les personnes concernées, ce dernier pourra leur envoyer un premier mail « neutre » afin de recueillir leur consentement à la prospection commerciale. Ce mail « neutre » devra comporter : les finalités des opérations de prospection, les mentions d’informations complètes du prospecteur, la source auprès de laquelle les données des prospects ont été recueillies, et enfin un mécanisme permettant de recueillir le consentement.
III. Comment encadrer les relations entre prospecteurs et primo-collectant des données ?
Plutôt qu’opposer les primo-collectant des données aux prospecteurs, il est préférable d’envisager une collaboration étroite entre ces derniers qui permettra d’une part de sécuriser les opérations de prospection commerciale du prospecteur, et d’autre part de valoriser le flux de prospects transmis par le primo-collectant.
Ainsi, en amont, prospecteurs et primo-collectant doivent encadrer contractuellement leurs relations. Ce contrat doit prévoir à minima :
- Les qualifications juridiques de chacun des acteurs, et le cas échéant inclure dans le contrat les mentions spécifiques relatives à la Sous-traitance[23] ou à la Responsabilité conjointe de traitement[24];
- Les obligations de chacun au regard du recueil valide du consentement, de la fourniture des mentions d’informations, ainsi que de la gestion des demandes d’exercice de droit ;
- La conservation et la documentation des preuves du consentement des prospects ;
- Et également, la responsabilité de chacun des acteurs en cas de manquement à leurs obligations.
De plus, tout au long de leur relation, ces derniers devront prévoir des mécanismes spécifiques afin de garantir le respect des obligations légales dont :
- La gestion des demandes d’exercice de droit des prospects dans un délai maximal de 1 mois, ainsi que la transmission effective de ces demandes entre les différents acteurs de la chaîne : telles les demandes de retrait du consentement, d’exercice du droit d’opposition ;
- La transmission des preuves du consentement des prospects, notamment pour démontrer leur validité dans le cadre d’un contrôle de la CNIL auprès de l’un des acteurs ;
- Lorsque cela s’avère nécessaire, la mise en place d’une campagne de recueil du consentement des prospects (notamment si seules les catégories de destinataires ont été fournies lors du recueil du consentement ;
- Et enfin, assurer la traçabilité du consentement des prospects, et la conservation d’une liste des prospecteurs pour lesquels ils ont consenti.
Dans tous les cas, une attention particulière doit être apportée à la sécurité des flux de données des coordonnées des prospects transmises entre le primo-collectant et le prospecteur[25].
———————————————-
BIBLIOGRAPHIE
[1] Le Monde Tribune de Lucie Audibert, et Eliot Bendinelli, Criteo : « La décision de la CNIL s’attaque à la chaîne de production de données irresponsable qui règne dans l’industrie publicitaire en ligne », publié le 30 août 2023, consultable en ligne : https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/08/30/criteo-la-decision-de-la-cnil-s-attaque-a-la-chaine-de-production-de-donnees-irresponsable-qui-regne-dans-l-industrie-publicitaire-en-ligne_6187094_3232.html
[2] Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
[3] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou « RGPD »), consultable en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
[4] Certaines règles de droit spéciales encadrent les opérations de prospection commerciale et de retargeting publicitaire, comme les articles L34-5 du Code des Postes et des Communications électroniques, ainsi que l’Article 82 de la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978
[5] CNIL, n°SAN-2023-015 du 12 octobre 2023 concernant la société CANAL +, sanction d’un montant de 600 000 euros, consultable en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000048222771
[6] CNIL, n°SAN-2023-009 du 15 juin 2023 concernant la société CRITEO, sanction d’un montant de 40 millions d’euros, consultable en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000047707063
[7] RGPD, Considérant 47 : « le traitement de données à caractère personnel à des fins de prospection peut être considéré comme étant réalisé pour répondre à un intérêt légitime »
[8] Loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, article 82
[9] Code des Postes et des Communications électroniques, Article L34-5 alinéa 1er
[10] RGPD, Article 7.1
[11] RGPD, Article 4.11 : le « consentement » de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement
[12] RGPD, Article 7.3
[13] Code des Postes et des Communications Électroniques, Article L34-5 4ème alinéa
[14] CNIL, La prospection commerciale par courrier électronique, 18 mai 2009, consultable en ligne : https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-courrier-electronique
[15] CNIL, La prospection commerciale par courrier postal et appel téléphonique, 26 janvier 2022, consultable en ligne : https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-courrier-postal-et-appel-telephonique
[16] RGPD, Articles 12 à 14
[17] RGPD, Article 21.1 à 21.4
[18] RGPD, Article 83.5
[19] Code Pénal, Article L226-21
[20] CNIL, FR, 24 novembre 2022, SANCTION, n° SAN-2022-021, publié, consultable en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000046650733?isSuggest=true
[21] RGPD, Article 13
[22] RGPD, Article 14
[23] RGPD, Article 28
[24] RGPD, Article 26
[25] RGPD, Articles 28 et 32